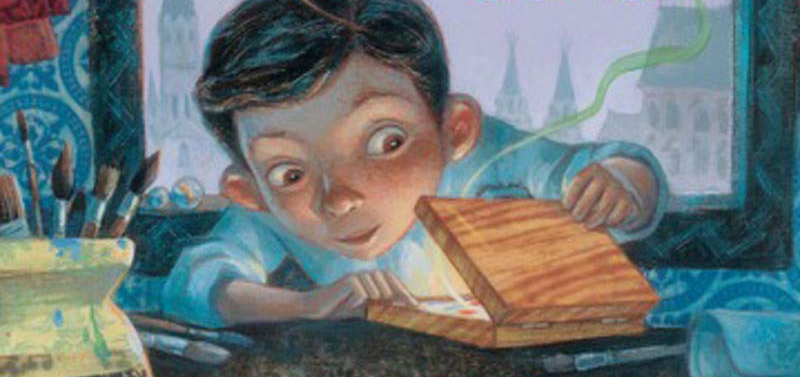James Stewart a le vertige. Ou plutôt, il est acrophobe : il souffre d’une peur panique du vide et des hauteurs. Il était policier mais, rongé par la culpabilité après la mort d’un collègue tombé d’un toit alors qu’il essayait de le sauver, il a démissionné. « Seul un choc émotionnel pourrait me guérir », dit-il. Une de ses connaissances lui fait part de son inquiétude concernant sa femme, Kim Novak, au comportement étrange. Elle serait hantée par l’esprit d’une ancêtre. Le mari craint qu’elle ne mette fin à ses jours et demande à James Stewart de la suivre pour éviter le pire. Ce dernier accepte la mission, mais il a peur du vide… Il verra l’héroïne se jeter du haut d’un clocher, tétanisé, impuissant à éviter ce qu’il croit être un suicide. Plus tard, il rencontrera une autre femme, toujours Kim Novak, qui lui rappellera étrangement la belle au clocher.
La peur du vide est ici une peur de se jeter dans le vide, une peur de perdre le contrôle, de chuter.
L’angoisse du héros, par un effet miroir, trouve sa mise en acte chez l’héroïne : Kim Novak chute dans la baie de San Francisco avant de chuter du haut du clocher.
D’où viennent les phobies ?
Les phobies, peurs excessives, irraisonnées, peuvent s’attacher à tout ou presque : phobies d’animaux, de phénomènes naturels, de la profondeur, du noir, de l’eau, des transports, des tunnels, des ponts, des ascenseurs, du sang ; phobies liées à des situations collectives ou interpersonnelles…
Le DSM-5 – manuel américain des troubles mentaux – classe les phobies en quatre catégories : trouble panique avec agoraphobie, agoraphobie sans trouble panique, phobie spécifique, phobie sociale. Classement nécessaire mais pas suffisant : la diversité des causalités des phobies n’est pas mentionnée, ni interrogée la façon dont elles s’articulent avec l’histoire singulière d’un individu.
Pour Freud, la phobie est une forme d’angoisse qui s’est fixée sur un objet – dans le film, la peur panique du vide. Cet objet externe devient alors dépositaire de l’angoisse interne. En évitant l’objet, on réduit l’angoisse. La phobie peut devenir le pivot autour duquel l’individu organisera toute son existence, contraint de mettre en place de complexes stratégies d’évitement.
L’objet de la phobie n’a pas un sens propre. Il est investi d’un sens particulier pour l’individu concerné, il est inséré dans une histoire dont les fils doivent être démêlés. C’est à un travail de déliaison d’anciennes et coûteuses stratégies psychiques qu’il faut s’attacher.
En mettant l’accent sur les circonstances de l’apparition de la phobie, sur ce qui l’a rendue nécessaire, on évite de la voir réapparaître sous une autre forme. C’est le risque lorsque l’on se contente de l’éradiquer.