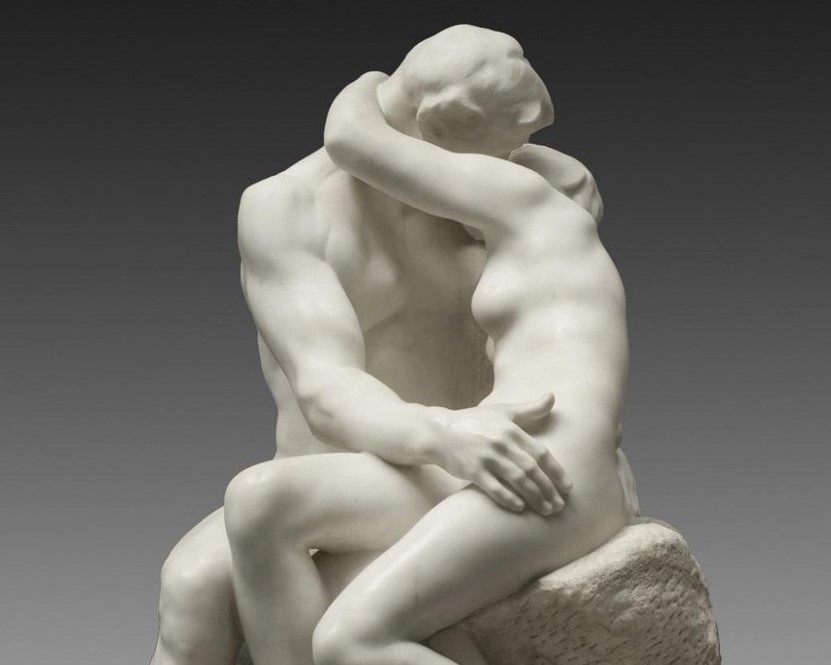« Être vivant, c’est être fait de mémoire. Si un homme n’est pas fait de mémoire, il n’est fait de rien. »
Philip ROTH, Patrimoine, une histoire vraie, Gallimard, 1992
Être fait de mémoire, c’est se souvenir, c’est ne pas vivre dans la seule instantanéité du présent. Du passé au présent, c’est la transmission qui fait le lien.
Il existe une évidence de la filiation, un poids de la généalogie. Notre destin est-il écrit à l’avance pour autant ?
La psychanalyse, on le lui reproche, serait du côté d’un déterminisme inconscient, de la rémanence d’une histoire infantile qui conditionne nos choix dans le présent.
Nous nous constituons avec ce qui nous est transmis, nous nous faisons l’écho de notre filiation. Les événements, les exils, les deuils, les bonheurs de la vie de nos parents, qu’ils soient dits ou cachés, nourrissent notre histoire consciente et inconsciente.
Cette petite fille, par le jeu des identifications, fera sienne l’idée d’un paradis perdu, idéalisera ce pays d’avant l’exil qu’elle n’a pas connu. Une fois adulte, elle ne se sentira jamais tout à fait à sa place, rêvera de « retourner » dans ce pays appartenant à l’enfance de ses parents. Elle trouvera sa réalité médiocre, décevante. Elle se sentira coupable.
C’est l’écart entre l’insuffisance de la réalité et l’exigence de l’idéal qui fait la culpabilité.
Transmission et surmoi
Le surmoi incarne cette notion de transmission. Pour Freud, l’appareil psychique est composé de trois instances : le moi, le ça et le surmoi. Le rôle du surmoi est celui d’un juge, d’un censeur à l’égard du moi.
Le surmoi est l’héritier du complexe d’Œdipe : il se constitue par intériorisation des exigences et des interdits parentaux. C’est en renonçant à la satisfaction de ses désirs œdipiens, frappés d’interdit, que l’enfant transforme son investissement sur les parents en identification aux parents. Il intériorise alors l’interdit.
Le surmoi est chargé de l’héritage des idéaux parentaux ; il mêle devoirs, ambitions et interdictions. « Le surmoi est la voix des morts qui veulent encore gouverner les vivants », écrit le psychanalyste Serge Vallon. Souvent, ils y parviennent.
Ce qui fait souffrir
Pourquoi ce qui est transmis serait-il source de souffrance ? Les descendants se sentent porteurs des désirs non réalisés de leurs ancêtres, ils héritent des illusions perdues de ceux qui les ont précédés. Ils doivent devenir ce que leurs parents, grands-parents, oncles ou tantes… n’ont pas réussi à être.
Ce qui est transmis n’est alors pas la réalité mais un idéal appartenant à une mythologie familiale et dont les enfants se sentent les dépositaires. Un idéal dont ils portent le poids sans pouvoir se le représenter.
Autre type de transmission traumatique : la répétition, dans le lien parent-bébé, des modalités pathologiques de lien appartenant à l’histoire infantile du parent. C’est la métaphore des « fantômes dans la chambre d’enfant » (Selma Fraiberg).
Les deuils impossibles se transmettent aussi, tels quels, aux générations suivantes. Ce sont des « cryptes », des douleurs non élaborées qui passent d’une génération à l’autre. Comme ce jeune homme qui choisit d’étudier l’archéologie, alors qu’il y a dans la famille un deuil, celui de son oncle, mort trop jeune, dont on ne parle pas. Sa tombe reste introuvable…
La transmission se présente alors dans le psychisme comme un impératif auquel on doit se soumettre.
La thérapie psychanalytique offre un espace de reviviscence où peuvent se formuler les deuils, les plaintes, les retrouvailles… irreprésentables. Pour nommer ce qui fait souffrir et que circulent les représentations. Pour réécrire une histoire inconsciente où se mêlent souvenirs et fantasmes. Une histoire faite d’héritage et d’invention.