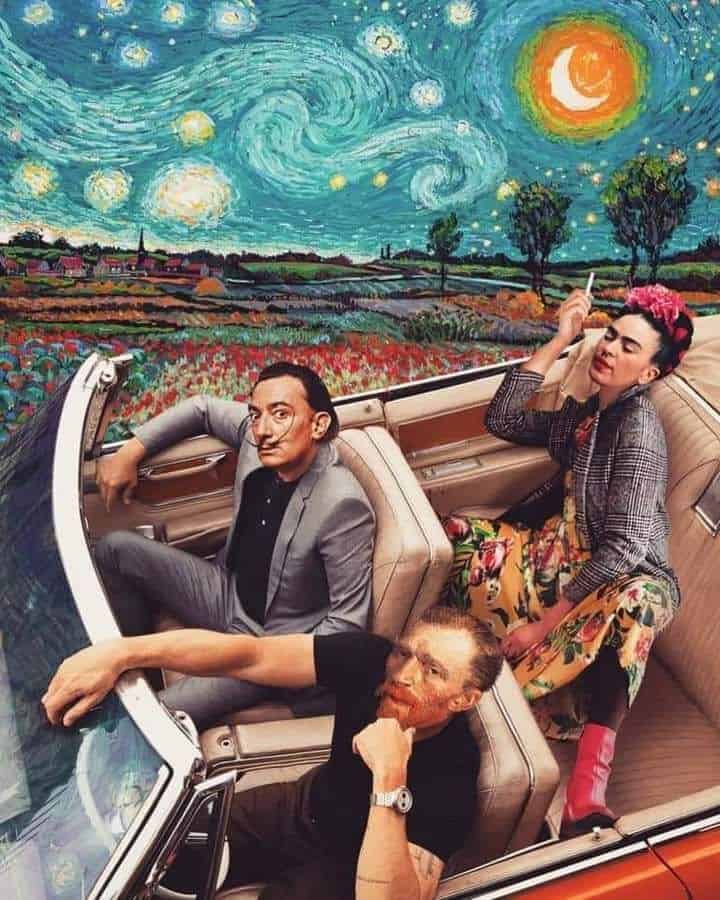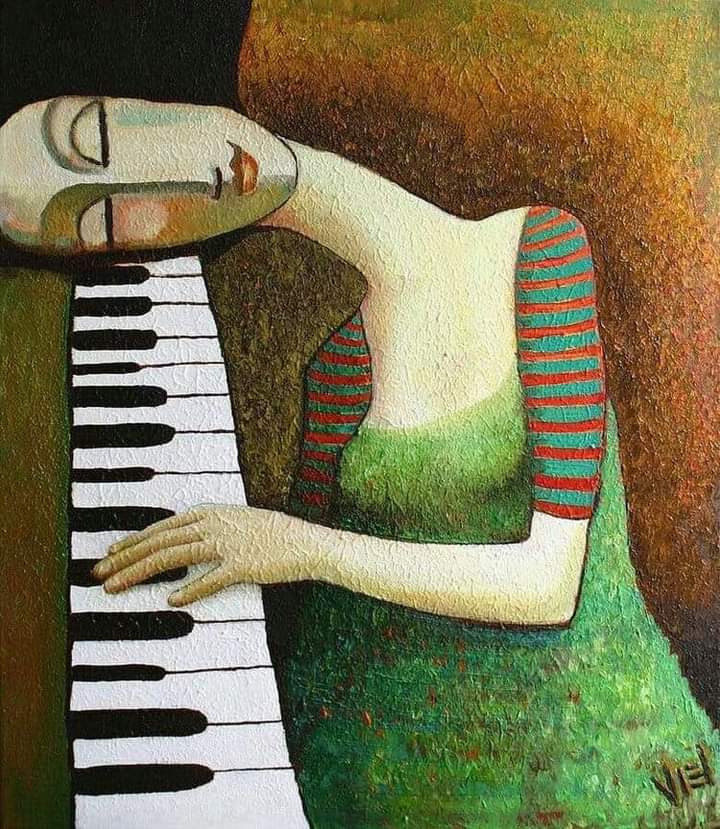C’est une femme en mouvement qui part rencontrer sa famille. De Strasbourg à Nancy, de Montpellier à Nice. Silhouette longiligne, cheveux très courts, elle porte sa souffrance en bandoulière.
Elle parle, elle interroge tandis qu’une autre femme la filme, comme pour laisser une trace.
Ces séquences sont entrecoupées d’images plus anciennes, des images intimes, tendres et ordinaires : une petite fille – un bébé – qui trottine dans le jardin avec son père, qui joue avec lui en bord de mer ; elle qui donne le biberon, qui l’emmène au manège, qui la regarde dormir. La date apparaît en bas de l’image, nous sommes à l’été 1995.
Le documentaire Une famille de Christine Angot ne ressemble à rien. À rien de connu. C’est un regard singulier, sensible, essentiel.
On est cette femme qui parle et qu’on n’entend pas. Qui parle de son père, des viols qu’elle a subis, des adultes qui n’ont rien vu, de l’absence d’une loi qui protège.
Son père, elle ne le connaissait pas, elle vivait seule avec sa mère et l’idéalisait. Il accepte enfin de la reconnaître et de la rencontrer alors qu’elle a 13 ans : c’est le début de l’emprise, des viols répétés.
Elle aimerait que son histoire existe dans le regard de sa famille, « avant qu’on disparaisse tous ». Ces viols, ils les ont vécus eux aussi. Mais qui peut l’entendre, cette vérité qui dérange ? « Je n’ai que ta version des faits », lui dit la femme de son père.
Son histoire est connue pourtant, elle l’écrit depuis des décennies. Hors du cercle familial, on l’entend, de mieux en mieux ; les victimes parlent enfin, ne se cachent plus, ne souffrent plus en silence.
Ça ne suffit pas. C’est à la femme de son père qu’elle s’adresse, à sa mère, à son ex-mari. Pourquoi n’avez-vous rien fait, où étiez-vous tous ?
La dernière séquence est celle d’une rencontre avec sa fille, avec celle qui n’était pas encore là, celle qui était bébé en 1995. « Je suis désolée, maman, qu’il te soit arrivé ça », lui a-t-elle dit. Ces mots, elle les entendait pour la première fois.